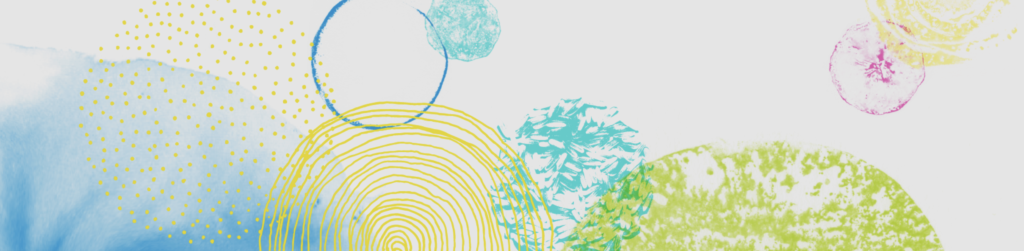Face au changement climatique, face à l’inflation des matières premières et de l’énergie, face à l’effondrement de la biodiversité, face au chômage et à la précarité alimentaire, l’agroécologie et les valeurs de sobriété, de qualité, d’équité et de respect qu’elle véhicule s’impose comme une solution globale aux grands défis à venir. La Fondation Daniel et Nina Carasso est pleinement mobilisée sur ce sujet aux côtés de ses partenaires, la Fondation de France, le Réseau Civam, Trame, la FADEAR et le réseau des CUMA.
Créées pour favoriser le partage d’expériences et d’initiatives inspirantes, les Rencontres de l’alimentation durable du 10 octobre 2023 auront pour objectif de croiser les regards entre disciplines et secteurs parfois encore trop éloignés malgré des convergences possibles. Nous vous proposons de partager nos ambitions pour nourrir les transformations qui s’imposent, autour des 3 thématiques : agroécologie, démocratie alimentaire et territoires.
Partager nos ambitions, nourrir les transformations
Les polycrises que nous traversons nous confrontent à des défis majeurs et entraînent parfois des réponses court-termistes, aux dépens de dynamiques systémiques, sur lesquelles repose pourtant la nécessaire transformation de nos modèles agricoles et alimentaires. Néanmoins, elles sont également porteuses d’opportunités inédites. Pour cette 4e édition des Rencontres, le moment est venu d’encourager les interactions entre les enjeux d’agroécologie, de démocratie alimentaire et des territoires et ainsi décloisonner les approches et pratiques pour porter une vision systémique de l’alimentation, à la hauteur des défis que nous avons à relever, et qui concernent plus encore les générations à venir.
Agroécologie et transition agroécologique
Nous considérons l’agroécologie comme une vision pouvant transformer toutes les formes actuelles d’agriculture et comme une inspiration sur les chemins pour y parvenir. Elle impose de profonds changements dans la façon d’analyser, d’évaluer et de concevoir tant les pratiques agricoles que les systèmes de production et d’échange avec l’aval. Elle implique l’abandon de solutions agronomiques standardisées et de court terme au profit de pratiques adaptées à leur environnement et aux personnes, qui intègrent des savoirs empiriques et qui sont inscrites dans le temps long des processus écologiques.
Démocratie alimentaire et droit à l’alimentation
Le fait que nous évoluons dans des environnements alimentaires contraints qui ne facilitent pas les choix alimentaires durables, est devenu de plus en plus visible et problématique ces dernières années avec les successions des crises et alors que la pression économique sur les budgets se fait de plus en plus forte. Ces environnements alimentaires sont façonnés par un très petit nombre d’acteurs : les institutions publiques et surtout les opérateurs économiques majeurs de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Ils ont un poids prépondérant sur ce qui est produit et proposé à la consommation aujourd’hui. Cependant leurs processus de décision incluent très rarement les citoyens et habitants, et ne prennent pas suffisamment en compte les coûts sociétaux de ces systèmes alimentaires (sanitaires, environnementaux, sociaux…).
Nous faisons l’hypothèse que la mobilisation de toutes les parties prenantes, la co-construction et la co-responsabilisation à l’échelle des territoires, l’inclusion de tous et toutes constituent des leviers d’action puissants pour permettre des transformations pérennes et significatives de nos systèmes agricoles et alimentaires. Cet aspect souvent peu considéré des processus de transition s’appuie sur la démocratie participative, l’éducation populaire, l’intelligence collective, l’autonomisation et le renforcement du pouvoir d’agir des personnes pour permettre la réappropriation des systèmes agricoles et alimentaires comme biens communs par chacune et chacun. L’ouverture des processus de décision, l’évolution des formes de gouvernance et de coopération et le renforcement de la capacité de tous à agir, y compris par l’appropriation de leviers économiques, dans la réorientation des systèmes alimentaires sont des enjeux majeurs pour mettre en œuvre des réponses à la hauteur des enjeux, au plus près des attentes et intérêts des populations.
Ces démarches de démocratie alimentaire doivent absolument intégrer les personnes les plus éloignées des instances de décision, en particulier les populations marginalisées ou en situation de précarité.
À travers le soutien à une grande diversité d’initiatives depuis plus de dix ans, nous avons pu observer une montée en puissance des approches mobilisant le « droit à l’alimentation », la « démocratie alimentaire » ou la « justice alimentaire ». Ces terminologies interrogent et sont mouvantes ; nous avons fait le choix pour ces Rencontres du thème chapeau de « démocratie alimentaire » : pour la Fondation Daniel et Nina Carasso, la démocratie alimentaire signifie que chacune et chacun des citoyens a la capacité de choisir les systèmes alimentaires auxquels il participe et d’agir pour les transformer. Nous insistons sur la nécessité d’avoir une attention particulière envers les personnes précaires et marginalisées.
Impacts et initiatives de l’Alimentation durable à l’échelle des territoires
Notre alimentation, de la production à la consommation, a un impact sur l’ensemble des territoires : biodiversité, climat, justice sociale, santé, emploi… De plus en plus d’acteurs s’emparent de ces sujets en développant des filières alimentaires de qualité et de proximité, des projets de reprise en main du foncier agricole, de justice et de démocratie alimentaire… Ces initiatives se développent plus particulièrement à l’échelle territoriale : dans les communes, les intercommunalités, les métropoles, les régions, en métropole comme en Outre-mer. En effet, c’est à cet échelon que les habitantes et habitants, les associations, les élues et élus, ou encore les techniciennes et techniciens des collectivités territoriales, se sentent parfois les plus concernés et en capacité de faire bouger les lignes.